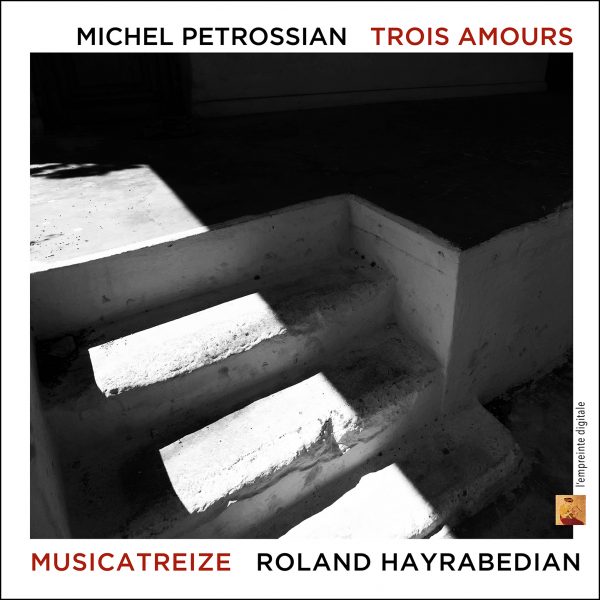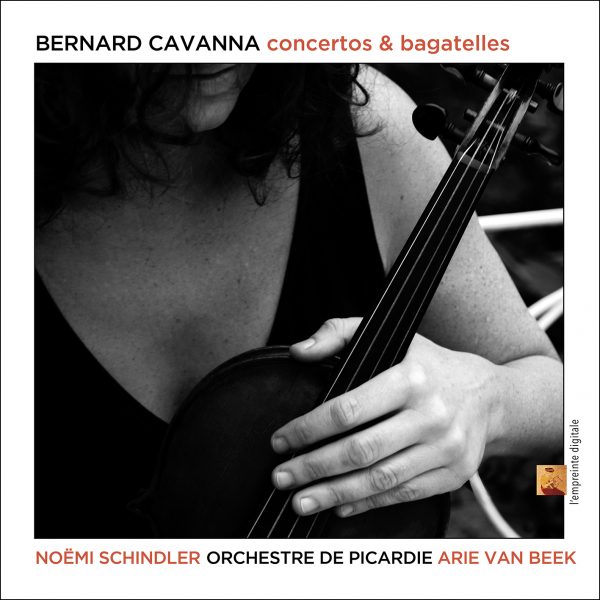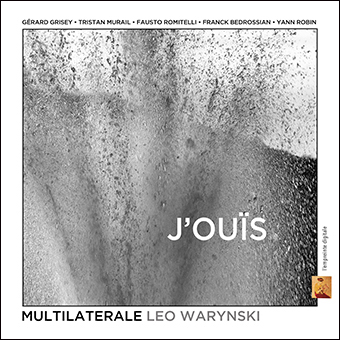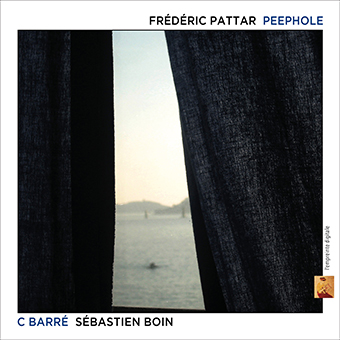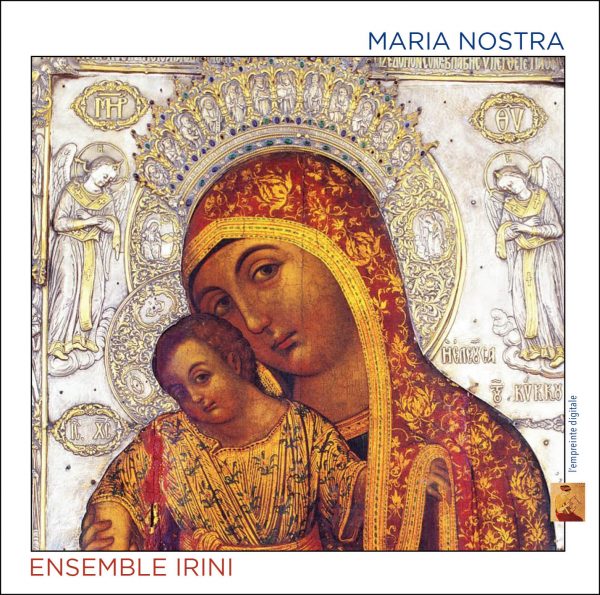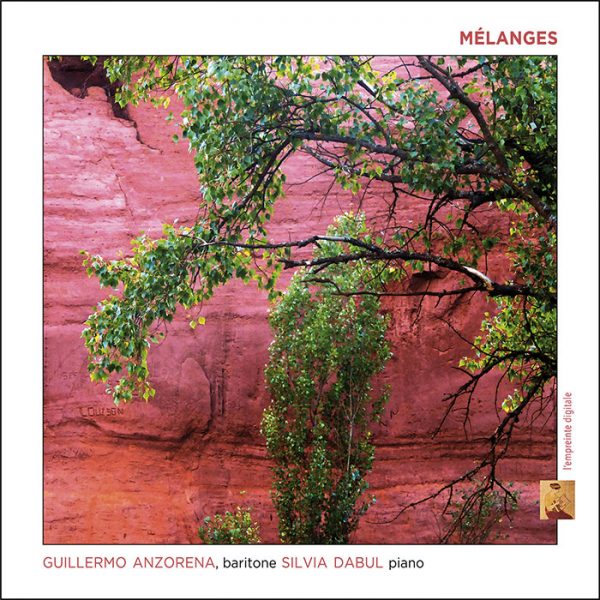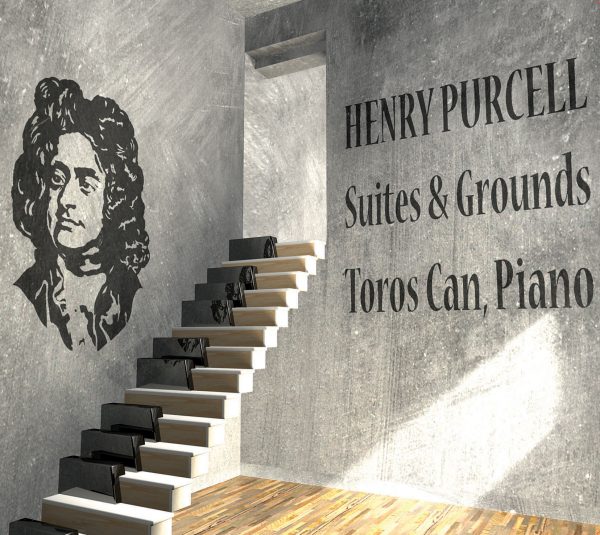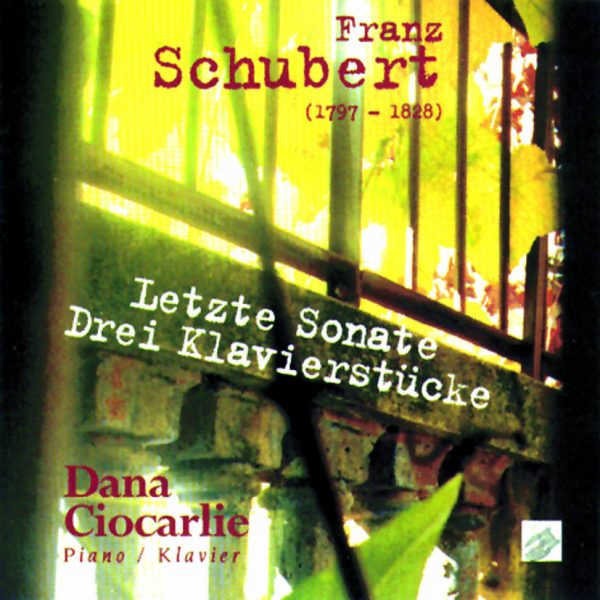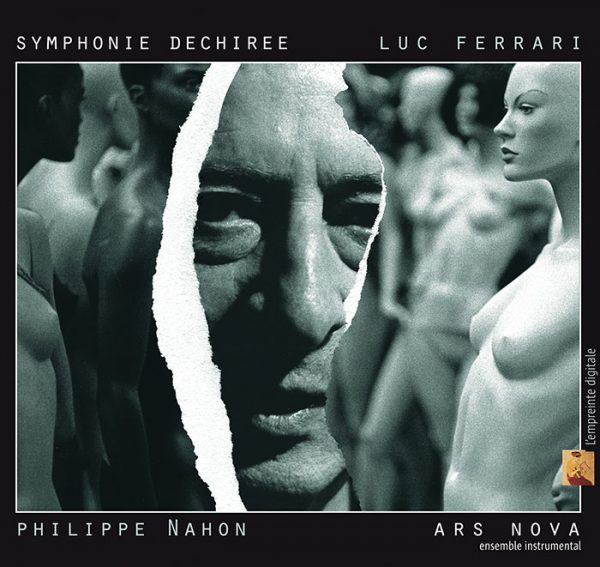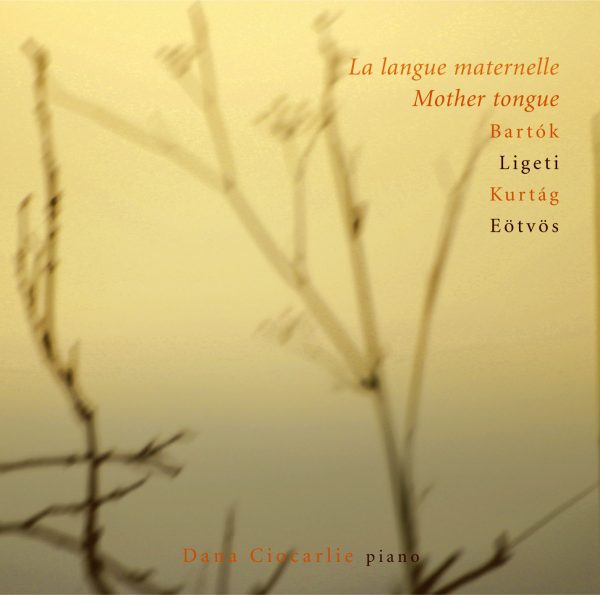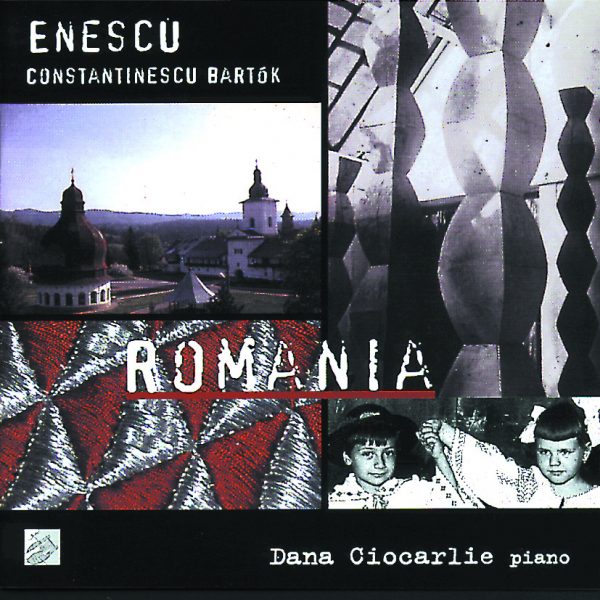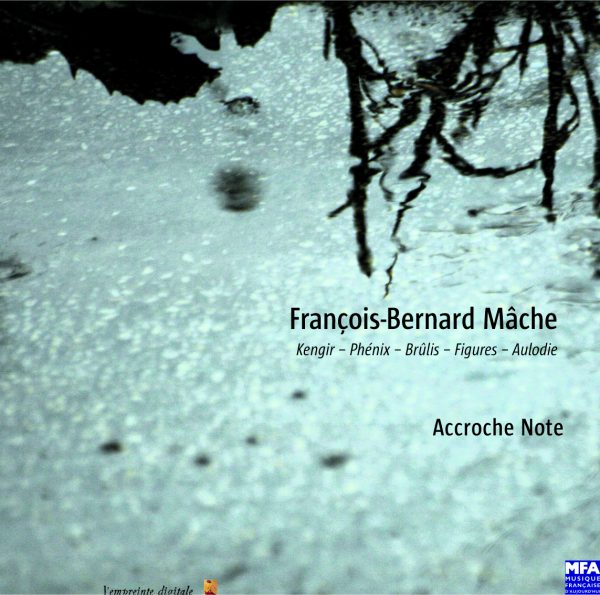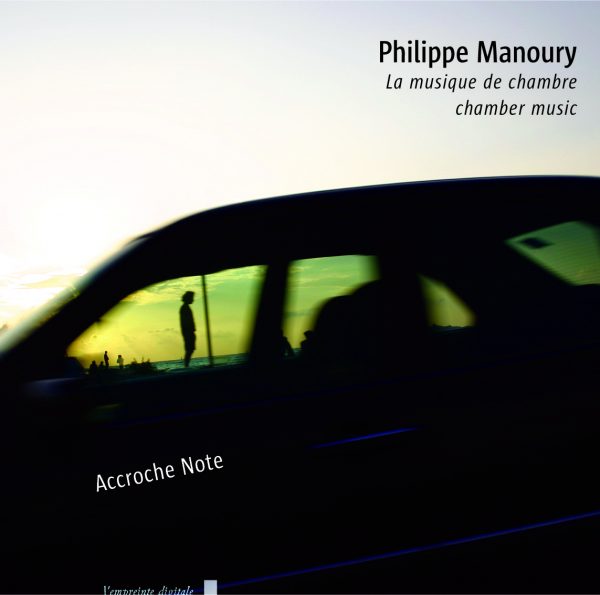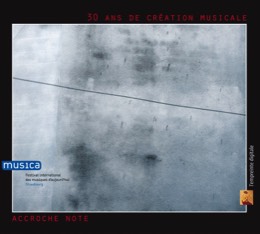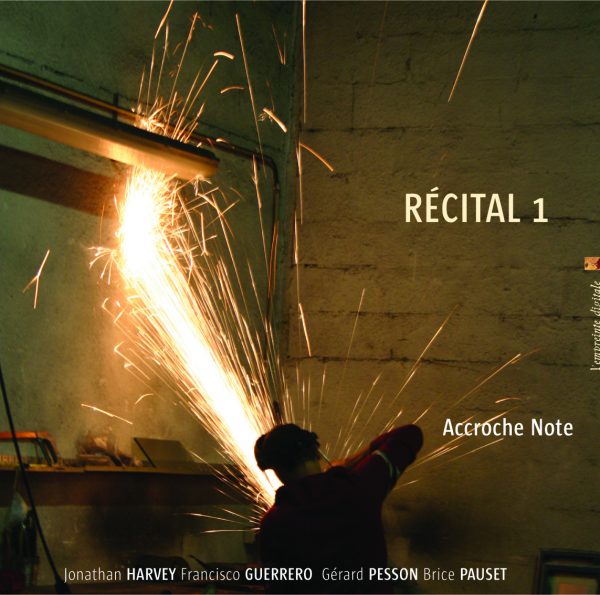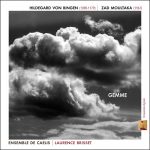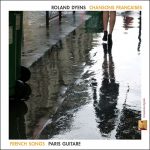Reicha / 3 Quatuors – Quatuor Ardeo
l’empreinte digitale ED13240
1 disque audio distribution Socadisc
ED13240 – © l’empreinte digitale 2014 – TT 63’56
PARUTION 6 novembre 2014
Trois quatuors monographie
Quatuor op. 49 n° 1 en do mineur
Quatuor op. 90 n° 2 en sol majeur*
Quatuor op. 94 n° 3 en fa mineur*
* premiers enregistrements mondiaux


 Anton [Antonín, Antoine] Reicha [Rejcha] (1770-1836) né à Prague, naturalisé français en 1829, est l’une des grandes figures musicales européennes du début du XIXe siècle. À la fois compositeur, théoricien de la musique et grand pédagogue, il est aujourd’hui toujours considéré comme l’un des esprits les plus brillants de son temps.
Anton [Antonín, Antoine] Reicha [Rejcha] (1770-1836) né à Prague, naturalisé français en 1829, est l’une des grandes figures musicales européennes du début du XIXe siècle. À la fois compositeur, théoricien de la musique et grand pédagogue, il est aujourd’hui toujours considéré comme l’un des esprits les plus brillants de son temps. Quatuor opus 94 n° 3 en fa mineur
Quatuor opus 94 n° 3 en fa mineur